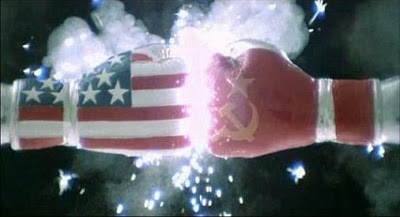Les
années 90, comme cela a été stipulé dans les précédents articles de notre dossier qui leur sont consacrés, ont bouleversé irrémédiablement les paradigmes que constituaient les oppositions de blocs et l'espérance utopique d'un monde meilleur, unifié et mondialisé qu'inspirait cette situation. Dans le cas du sport, les bouleversements durant les années 90 ont été progressifs et indolores : apparition du
sport business, émergence de nouvelles nations du sport sur les
cendres du bloc communiste, premières révélations de
dopage planifié en ex-RDA,
instrumentalisation des organisations sensées régir le sport mondial...
Nombreux sont les exemples qui tendent à prouver que les exploits de
Mark Spitz ou des
Verts de
Saint-Etienne appartiennent définitivement au passé. Et pourtant cette décennie a fourni son lot d'exploits, et comme durant les périodes qui précédèrent les années 90, il a été possible de s'extasier devant la beauté du sport à maintes reprises, notamment grâce à l'état d'esprit vertueux de certains champions qui ont enfilé records et titres comme des perles. Ces sportifs au dessus du lot, devenus rares, ont bel et bien marqué l'
histoire du sport à tout jamais.
Le modèle Sport Business européen : le football
Le bouleversement le plus marquant de cette décennie se situe au niveau de l'apparition visible de l'argent massivement dans certains sports. En créant de nouveaux formats de compétitions plus rentables, certaines organisations sportives mondiales ont réussi à renégocier les
droits TV et à intéresser des
annonceurs sentant les bons coups à jouer.
Le meilleur exemple illustrant cette évolution est le football, notamment quand l'UEFA décide de remodeler en 1992 la vieille
Coupe des Clubs Champions en
Champions League. Les participants à cette nouvelle formule allaient être désormais stimulés par une grille de primes monstrueuses offertes par l'
UEFA pour une simple participation, les victoires, les matchs nuls et le parcours effectué durant la coupe. La hausse des droits TV et les contrats juteux avec les marques ont essentiellement permis ce changement. De plus, un système de poules avec matchs aller et retour permettant de déterminer les
16 qualifiés pour le dernier round est alors mis en place. Cela provoqua naturellement une augmentation du nombre de matchs à jouer - ce qui nécessite encore plus de régularité - spécialité des clubs ayant les plus gros effectifs et qui peuvent les faire tourner.

Mais pour que les matchs soient attractifs et que tout le monde ait sa part du gâteau, il a fallu aussi s'assurer que les équipes qui représentent l'histoire du football européen participent tous les ans à cette compétition (
Liverpool,
MU,
Real Madrid,
FC Barcelone,
Juventus,
Milan AC...), sur la base de quotas liés à des indices
UEFA qui reprennent une moyenne de résultats sur une période donnée. Régularité, argent, palmarès...Autant dire quasiment plus aucune chance que des clubs "petits poucets" ne remportent cette compétition, comme ce fut le cas parfois dans le passé.
Parallèlement à ce bouleversement structurel, des hommes d'affaires influents prennent les commandes du
foot business :
Sylvio Berlusconi en est le meilleur exemple quant il décide de racheter l'
A.C Milan en 1986 et d'investir massivement pour bâtir une équipe qui deviendra la meilleure au monde durant presque une décennie, grâce à son trio hollandais magique :
Ruud Gullit,
Frank Rijkaard,
Marco Van Basten. Les années
Tapie à l'
OM marquent également en France l'apogée du rapprochement entre l'argent et le foot, ce qui conduira le club à offrir à la France en
1993 contre l'A.C Milan (justement) sa première coupe d'Europe après des décennies de disette. Il est vrai que le président
Bez avait montré la voix peu avant à Tapie avec les
Girondins de Bordeaux, ce qui conduit d'ailleurs la
DNCG à rétrograder son club en 1990-1991 pour déficit budgétaire.
Face à cette montée en puissance du foot business, les effets pervers se font vite sentir. Des
scandales éclatent à tous les niveaux du foot :
Affaire Glassman (OM/VA), rumeurs de matchs achetés dans le
Calcio (le scandale finira par éclater dans les années 2000), transferts bidons, blanchiment d'argent... mais la machine est lancée et bien trop rentable pour s'arrêter.
15 décembre 1995 - Arrêt Bosman. Désormais les équipes ne sont plus limitées dans leur recrutement et les clubs les plus riches peuvent acheter et faire jouer autant de stars internationales dans une même équipe pour un même match officiel.
Cela met fin aux derniers espoirs de revenir à un football propre et moins tourné vers l'argent et la rentabilité.
Le modèle sport business américain : le basketPendant ce temps-là de l'autre côté de l'Océan Atlantique, le
basket fait recette. Mais pas de la même manière qu'en Europe. Pour en parler, il faut remonter en 1950, lors de la création de la
NBA, qui verra le jour après la fusion des 2 ligues de baskets majeures du pays. Depuis cette date, le championnat est divisé en 2 conférences, Est et Ouest. Les équipes deviennent de fait des franchises de la NBA. Cela leur laisse toutefois une certaine liberté juridique et financière, et surtout la possibilité de changer de ville (la franchise des
Lakers était à l'origine à Minneapolis avant de partir s'installer à Los Angeles). Toutefois, c'est la NBA qui décide chaque année du nombre de
franchises qui participeront au championnat de basket national, et non leurs résultats de l'année précédente en championnat.

L'histoire de la NBA commence à décoller véritablement à partir des années 80 avec l'arrivée des premières stars du basket US comme
Lary Bird (3 titres avec les Celtic Boston) et
Magic Johnson (5 titres avec les Los Angeles Lakers), qui deviendront de véritables légendes dans leur pays. Les marques américaines commencent alors à s'intéresser de près au basket. Il est vrai que le
salary cap défini par la NBA ne permet pas aux franchises d'avoir champ libre en terme de salaires et primes pour attirer les stars montantes. Les marques, via les contrats publicitaires astronomiques proposés aux joueurs, profitent de cette faille. Elles joueront un rôle majeur dans l'apparition du premier
sport 100% business aux USA, et bientôt dans le monde entier.
Un joueur de basket va révolutionner le basket américain et en faire un produit exportable partout dans le monde. Ce joueur, c'est
Michael "Air" Jordan. Il est déclaré athlète et basketteur de la décennie 90. En 1992, il gagne la totalité des récompenses et trophées nationaux de basket avec son club des
Chicago Bulls et internationaux avec son pays, les
USA. Il sera champion NBA 6 fois entre 90 et 98. Le potentiel exportable des produits griffés "Michael Jordan" atteindra un tel niveau qu'il restera le sportif le plus payé au monde pendant très longtemps. Son image sera longtemps associée à l'invincibilité sportive, et très souvent reprise par des campagnes publicitaires dans le monde entier. Dans la foulée, d'autres basketteurs bénéficieront de "
l'
effet Jordan" et les meilleurs joueurs de la planète commenceront alors à affluer en NBA. Il faudra attendre 1997 et la venue de
Tariq Abdul Wahad pour voir le premier français jouer en NBA.
Les 2 modèles sont-ils si éloignés ?L'
UEFA et la
NBA ont utilisé des modèles économiques différents pour asseoir leur domination sur leurs sports respectifs. L'UEFA, qui se trouve en situation de monopole en Europe, a favorisé l'investissement de businessmen dans les clubs de foot et poussé l'Union Européenne à légiférer pour ultra-libéraliser les transferts de joueurs (
Arrêt Bosman). La NBA, quant à elle, a régulièrement été en concurrence avec d'autres ligues, la poussant dans un premier temps à encadrer les équipes par un système de franchises, puis à se développer à l'international grâce à la puissance de ses marques et de ses stars.
Ces différences ont fait naître
une élite de clubs dans le football européen, alors que le niveau des franchises américaines semble plus homogène. Des similitudes dans leurs modèles économiques se retrouvent toutefois au niveau de leur stratégie en termes de
droits de diffusion TV à l'étranger. Les deux structures ont basé une partie de leur indépendance financière sur la vente des ces droits, et ont parallèlement fait en sorte que les compétitions soient attrayantes et rentables. Dans ces conditions, peu de chances que l'
AJ Auxerre (Bourgogne) remporte un jour la Champions League ou que
Frederick (Maryland) remporte un jour les plays-offs !!!
A venir : 2. La redistribution des cartes à l'Est3. Les scandales et le dopage dans le sport4. Des exploits quant même ?